L'eau est un élément vital. A l'heure où les chercheurs
sont déjà sur la piste de l'eau artificielle, dans les
campagnes environnantes, la rivière le Tilleul, les ruisseaux
de la Haie portée et des Fortinières, coulent encore.
Qu'elle soit source de conflits ou de retrouvailles, qu'elle soit un
objet de recherche ou de détente, qu'elle soit associée
au travail ou aux loisirs, l'eau, comme les autres éléments
de notre planète, est indispensable.
- le Pont de St Morice nous permet
de considérer l'eau-frontière et la rivière comme
le lieu de vie de tout un village
- les Sources de St URSIN parlent
des effets thérapeutiques d'une eau aux vertus légendaires
- L'Etang de CADIN, lui, laisse apprécier
la sérénité d'un lieu sauvage en apparence mais
géré en réalité avec discernement par
la main de l'homme.
- le Lavoir suggére la vie, les échanges
et les chansons des laveuses et autres lavandières.
- Les Puits
- Le Captage de la TOUCHEFOUILLERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE PONT
DE SAINT MORICE : fragments de vie d'un village d'eau
A l'endroit du pont, il y avait autrefois un gué par où
les hommes passaient, eux et leurs animaux. Parfois, l'eau touchait
le ventre des chevaux et ils n'appréciaient pas beaucoup, même
si la rivière leur servait d'abreuvoir puisqu'il n'y avait pas
d'eau dans les étables. Plus tard, il y eut un pont en pierre
de granit taillé dans les carrières d'Orgères la
Roche. Ce n'est que dans les années 50, que la DDE remplaça
ce pont par celui qui existe actuellement, en se servant toutefois des
pierres de granit pour les remblais. C'est en 1955 que l'eau est arrivée
directement dans les maisons, avec un simple robinet pour quelques années
encore. La même année la bouche à incendie fut installée.
Avant cette cate, le village de St Morice qui compta jusqu'à
une quinzaine de foyers, s'alimentait en eau a la rivière, le
Tilleul, ou dans les puits que les habitants avaient fait construire
à l'aide des sourciers, plus nombreux à cette époque.
Les trois puits, allant puiser l'eau à cinq ou six mètres
de profondeur, servaient à tous. On ne se posait pas la question
de savoir à qui appartenait l'eau ; tout le monde en avait besoin.
Les habitants la buvaient, personne n'analysait cette eau qui était
plus saine qu'aujourd'hui. On trouvait également un lavoir à
la rivière où les femmes allaient « taper »
le linge, même l'hiver, pourtant plus rigoureux qu'aujourd'hui.
Mais les gens allaient aussi laver leur linge au captage de St Ursin,
où l'eau était plus chaude.
Si la rivière était un lieu de rencontre et de travail,
c'était aussi le terrain de jeu favori des enfants du village.
Il n'y a que quelques décennies de cela, elle regorgeait d'anguilles
qui remontait les rivières depuis l'océan Atlantique,
de brochets, de gardons, de truites et d'écrevisses. Il arrivait
parfois que la mère de famille se demande : « Qu'est-ce
que je vais faire à midi ? ». Il n'était pas rare
alors que les enfants descendent à la rivière et reviennent
avec sept ou huit truites. D'autres fois, c'était un genre de
merlu qui séchait au coin de la cheminée pour être
prêt le vendredi. Même dans les fossés, l'hiver,
on pouvait trouver des écrevisses ou des petits vairons.
Les enfants attrapaient les anguilles avec du sable. Ils attrapaient
les poissons à la main grâce aux pierres qu'il y avait
dans le fond. « On était tous malins pour ça »,
raconte l'un d'eux. Avant Noël, les truites, elles aussi, remontaient
le circuit des rivières. « On ne les prenait pas parce
qu'elles étaient amères, à cause qu'elles frayaient
». Les écrevisses, elles, nécessitaient parfois
une technique plus élaborée : il fallait mettre un lapin
crevé dans une balance. Ça attirait les écrevisses,
ou bien, c'était un poisson sur lequel on mettait un peu d'essence
de térébenthine (autorisée).
En tous les cas, « les gens se contentaient, ils en prenaient
comme ça, pour leur consommation personnelle , pas pour en faire
le commerce ».
La pollution, les aléas du climat et l'introduction d'autres
espèces ont eu peu à peu raison de cette faune. Ainsi
en 1976, on repêcha plein de truites mortes asphyxiées
comme, dans une moindre mesure, durant l'été 2003. Les
truites d'élevage, elles, ont la réputation d'éliminer
les jeunes truitelles sauvages.
LES
SOURCES DE SAINT URSIN : une source providentielle
Un lieu religieux jusqu'en 1790
Au début du XIVème siècle, Guillaume de Doucelle,
exécuteur testamentaire de Guy VIII de Laval en 1295, souhaitait
fonder un prieuré à Saint-Ursin.
En 1434, le prieuré reçut des lettres de sauvegarde des
Anglais. Il subit le pillage des hugenots qui enlevèrent le prieur,
Jacques Dupont. Cependant l'établissement était encore
prospère au XVIème siècle et pendant la première
moitié du XVIIème. En 1510, à la suite de donations,
héritages et achats, il recouvrait une superficie de 90 ha, laquelle
atteindra 120 ha un siècle plus tard. Malgré la «
suppression de droit », M.Léchevin conserva son titre de
prieur jusqu'en 1790.
La chapelle, d'après les restes de ses fondations, pouvait présenter
une forme de 26 m de long sur 8 m de large.
Une eau bénéfique
« Le lieu-dit St Ursin porte le même nom que le ruisseau
qui y paresse avant d'aller grossir la Gourbe. dans le département
de l'Orne (...). En effet, avant sa captation par Bagnoles-de-1'Orne,
cette eau sortait de terre à une température d'environ
14°6. On venait à jeun y plonger la chemise des nouveaux-nés,
celle des enfants atteints de convulsions ou de maladie de peau ou tout
simplement le linge de corps personnel pour se préserver des
maladies ».
Et une eau source de conflit
« La source de St Ursin fut l'objet d'une demande en expropriation
par la cité thermale de Bagnoles-de-l'Orne.
Voir plaque sur pilier de l'hotel "le Nouvel Hotel" de Bagnoles Chateau
VOIR la suite
(Source : La Mayenne De village en village de Gilbert Chaussis (Siloë
Editeur))
L' ETANG
DE CADIN
De l'étang de Cadiou, une force motrice...
L'étang s'appelait, au début du XVIIIème siècle,
l'étang de CADIOU. Il servait à alimenter un moulin qui
se trouvait en aval de l'étang, moulin muni de deux ou trois
roues. Une réserve permettait déjà d'alimenter
le moulin en eau de manière suffisante lorsque le meunier le
redémarrait après une nuit de sommeil ou après,
le dimanche. Pour le remettre en route, le débit devait être
en effet suffisamment puissant pour actionner les deux roues. L'eau
chutait ensuite de quatre mètres. Le débit pouvait, et
peut toujours, être réglé selon l'ouverture et la
largeur des vannes. Les eaux supérieures ont plus de débit
que les eaux inférieures. A l'intérieur du moulin, les
masselottes, des poids en bronze enfilés sur une tige fixée
aux essieux indiquaient, dès que leur rotation atteignait une
certaine hauteur, qu'il fallait ralentir le débit. Dans ce cas,
le meunier allait au « moine » remettre une ou plusieurs
des planches qui servaient à barrer le passage de l'eau. Le «
moine » de l'étang de Cadin comporte plusieurs rangées
de deux planches séparées par du sable ou de la glaise
pour garantir une meilleure étanchéïté. Un
bief part également du moulin pour alimenter des forges autrefois
situées plus en aval.
...A l'étang de Cadin, un milieu vivant
Cet étang de quatre hectares nécessite, comme tout plan
d'eau, un entretien régulier. Celui-ci est « vidangé
» tous les deux ans. Cela lui permet de se ré-oxygéner,
permettant ainsi aux plantes et aux poissons et autres animaux de mieux
se développer. Cette oxygénation se fait également
par la lumière du soleil ou, la nuit, par le vent. Carpes, tanches
et gardons constituent l'essentiel des espèces de poissons présentes
dans cette eau dite de première catégorie. Les herbiers
ont été remplacés par les algues vertes dont la
présence est favorisée par le nitrate. Les canards, les
poules d'eau, les hérons et les cormorans fréquentent
paisiblement cet espace naturel. Leur faible poids leur permet en effet
de pouvoir s'abriter dans les dangereuses tourbières qui entourent
le plan d'eau.
Des réservoirs et une pêcherie sont les dernières
installations réalisées.
DE LA BUEE AU
LAVOIR
Jusqu'à la fin des années 1970, les jeunes filles du canton
étaient priées par leurs parents, par leur mère
principalement, d'aller au lavoir car elles avaient leurs « petites
affaires ». Elles commençaient progressivement, avec leurs
parents et à mesure qu'elles avançaient dans la vie, elles
géraient leur lessive toute seule.
Deux ou trois fois par an maximum, on faisait la « buée
», la grande lessive, dont la procédure est en partie expliquée
dans "Le savoir-faire et le savoir-vivre,
Guide pratique de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles
». Librairie Larousse, publié avant la guerre 1914-1918
:
« On appelle lessive la dissolution aqueuse de potasse ou
de soude dans laquelle on fait macérer le linge que l'on veut
blanchir. Anciennement, on faisait la lessive avec des cendres, et ce
procédé est même encore suivi actuellement dans
les campagnes et dans les petites villes de province. Pour lessiver
le linge par cette méthode, on le dispose pièce à
pièce dans un grand cuvier en bois (souvent en sapin ou en peuplier,
dans un bois sans tanin), placé sur un trépied, puis on
le recouvre d'une grosse toile qui déborde tout autour. On met
sur cette toile une quantité de cendres proportionnelles à
la masse de linge que l'on doit lessiver ; puis on enroule tout autour
les bords de la toile, de façon à former une sorte de
bassin dans lequel on verse peu à peu et par intervalle de l'eau
chaude qui s'infiltrant à travers les couches de linge, gagne
la partie inférieure d'où elle s'écoule par un
robinet. On reprend le liquide écoulé, on le chauffe et
on le renverse sur la cendre et ainsi de suite ; c'est ce qu'on appelle
couler la lessive. Il faut employer l'eau à une température
douce, qui permette aux tissus ce se gonfler par degrés, et de
se laisser plus facilement pénétrer. Toute eau qui dissout
bien le savon (comrne l'eau de pluie par exemple) est excellente pour
la lessive ».
Souvent, à partir d'une certaine époque, il y avait un
tuyau de fonte qui reliait le cuvier au chaudron qui, lui, était
placé sur le feu alimenté en permanence. L'eau était
ramenée du chaudron à la cuve grâce à un
vide-buée qui, de fait, est un petit seau fixé au bout
d'un manche. Le sac de cendres pouvait se trouver au fond du baquet
et ce pouvait être aussi du jus de lierre ou du « cristo
» qui était utilisé comme lessive.
La buée pouvait durer quatre ou cinq jours, avec la journée
du prélavage où il fallait tremper le linge dans l'eau
tiède la veille au soir, la journée même de la buée,
le rinçage au lavoir, l'essorage à la main, et, enfin,
le séchage, qui prenait de la place, sur des piquets, les fils
de fer, les haies. C'était une corvée de village. Les
voisins venaient pour aider.
C'est à la phase du rinçage qu'intervenaient les lavoirs.
Les femmes emportaient donc le linge à rincer comme elles pouvaient,
dans les brouettes, ou sur le guidon du vélo. Avec leur «
casseau », ironiquement appelé carosse, composé
d'une planche à l'avant, une au fond et une de chaque côté.
Les laveuses étaient à genoux là-dedans avec de
la paille ou un sac de jute. Elles avaient aussi, bien sur, le battoir,
utilisé pour les linges de grosse toile. Pour les trousseaux,
en faisait des petites lessives.
Comme on n'avait pas de quoi emporter tout le linge d'un seul coup,
on faisait plusieurs allers-retours entre le lavoir et la maison. Les
premiers lavoirs communaux sont arrivés dans les années
1930 mais chaque village avait son lavoir, c'était obligé,
parfois c 'était deux ou trois pierres assez larges posées
sur la berge d'une rivière. Ce qui signifie aussi que les villages
n'étaient jamais très éloignés des points
d'eau.
On imagine bien que dans ce temps-là, le linge, c'était
quelque chose. On pouvait ainsi disposer de quatre ou cinq douzaines
de chemises et trois dizaines de draps, ce qui explique la taille des
armoires. Et pas de n'mporte quel drap ou de n'importe quel vêtement
puisqu'il s'agissait essentiellement de toiles de chanvre. Qu'on pouvait,
après le lavage, repasser avec des fers en fonte, racommoder
ou amidonner pour les grandes occasions : mariages, enterrements, la
Toussaint, Pâques.
Tant de linge à laver avec ces moyens qu'on trouvait des laveuses
professionnelles qui allaient faire les lavages de maison en maison,
de quinze jours en quinze jours ou d'une semaine sur l'autre pour les
grandes familles. Elles se retrouvaient avec les autres aux lavoirs.
C'étaient la brosse et le savon pour les lavages "ordinaires
». Elles mettaient alors beaucoup de savon : du noir pour les
bleus et du blanc ou du rouge pour les blancs,du savon fait avec du
suif, de la graisse de boeuf.
Souvent, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Les laveuses
professionnelles avaient leur place attitrée. Il y en avaient
qui essayaient de se piquer des places. Elles y allaient tous les jours.
C'est ça qui était dur d'être à genoux du
matin au soir. L'hiver, il fallait casser la glace pour laver le linge.
Il fallait leur porter le jus avec une petite "goutte "dedans.
C'était pas toujours marrant. Mais le lavoir c'était aussi
le "petit journal ". Si on voulait avoir des nouvelles du
pays, il fallait venir au lavoir. Et pour se distraire, on poussait
la chansonnette par exemple :
« Josette, elle s'est payée une toilette
De satin, de grand prix
Elle ferait mieux la coquette
De payer ses plaisantes dettes
Et de garnir mieux son logis »
Entre le cuvier et la machine à laver, on trouve la lessiveuse,
dont les premières sont apparues dans les années 1930.
Cet ustensile faisait d'ailleurs parfois un très beau cadeau
pour les jeunes filles.
LES PUITS
Puits de la Godardière
Puits en propriété indivise qui servait à alimenter
un lavoir, qui existe depuis le 19eme siècle. Il s'agissait probablement
d'une fontaine auparavant. Tout le village avait accès au puits,
sans distinction. L'eau du puits servait également à étancher
la soif des bêtes qui venaient paître des les champs à
proximité, même si leur propriétaire n'habitait
pas le village.
Apprenez maintenant et en quelques lignes seulement à forer un
puits !
Les puits sont alimentés soit par des sources souterraines, soit
par des infiltrations venant de la surface du sol que l'on nomme pleurs,
soit par des infiltrations de rivières ou nappes d'eau voisines.
Les puits alimentés par des sources donnent généralement
une eau saine mais quelquefois minéralisée et peu aérée.
Les puits alimentés par des pleurs ou infiltrations sont sujets
à caution ; on doit en faire analyser l'eau.
Les puits creusés à proximité d'une fosse d'aisance,
d'un fumier ou d'un égout quelconque sont dangereux à
cause de la possibilité d'infection de l'eau par les infiltrations
dans le sol.
Les puits ordinaires
Les puits creusés de la main de l'homme avec la bêche,
le pic et la pelle sont construits dans nos campagnes par des puisatiers
ou simplement par les maçons. On leur donne la forme circulaire
ou un peu ovale, afin que la maçonnerie résiste bien à
la poussée des terres. Le creusement se fait avec les outils
usuels des terrassiers, à moins que l'on ne rencontre des bancs
de roches dures qu'il faut réduire par la poudre ou la dynamyte
au moyen de trous de mine percés dans des directions convenables.
Les précautions à prendre contre l'éboulement des
terres sont le plus souvent négligées et c'est à
cela qu'on doit attribuer les accidents qui surviennent au cours de
ces travaux. Il est de toute nécessité d'étayer
les parois du puits, au fur et à mesure de son avancement, par
des boisages correctement faits, c'est-à-dire par des palplanches
étançonnées entre elles au moyen de madriers taillés
à la longueur convenable. Ces boisements doivent être faits
partout dans la traversée des couches de terre. Nous avons vu
en effet des terres argileuses très fortes s'ébouler dans
ces sortes de creusements sous la charge des terres supérieures
et de petites infiltrations d'eau. Les déblais sont retirés
avec un seau ou une benne et un treuil à bras ou à manège.
Les puits tubes ou instantanés
Ces puits se font en enfonçant un tube en fer, muni à
son extrémité inférieure d'une pointe aciérée
percée de trous, dans un sol facilement pénétrable,
au moyen d'un mouton.
L'enfoncement du tube de 3 à 8 mètres de longueur jusqu'à
la rencontre de la nappe d'eau, ne demande souvent que quelques heures
et certains de ces tubages pratiqués dans des eaux abondantes
sont susceptibles d'un débit régulier de plusieurs mètres
à l'heure.
Les puits instantanés peuvent être installés, de
préférence aux puits creusés ordinaires, partout
où la nappe d'eau se trouve à moins de 8 mètres
de profondeur. Il peut être fait avec certitude de succès
dans tous les vallons sur le bord des rivières, et partout où
on trouve des puits alimentés par une nappe d'eau souterraine
circulant dans les graviers, à une faible distance du sol.
Le premier soin à prendre est de s'enquérir si possible
de la profondeur à laquelle on trouvera l'eau, en se basant sur
les puits les plus voisins. On évite ainsi les tâtonnements
et l'on sait d'avance la longueur du tube à enfoncer.
Extrait de L'eau à la campagne de René Champly, Librairie
des sciences pratiques des Forges, 1934
LE
CAPTAGE DE LA TOUCHEFOUILLERE
Le captage de la Touchefouillère, comment ça
marche ?
L'eau, il faut aller la chercher en profondeur pour la trouver en quantité
suffisante pour alimenter une commune. C'est le rôle d'un captage
comme celui de la Touchefouillère, réalisé en 1978.
C'est l'unique point d'approvisionnement en eau pour la commune de Lignières.
Mais le premier captage de la commune était situé aux
Noës (nord-est du territoire communal) et permettait d'alimenter
gravitairement le réseau. Sa faible productivité en période
d'étiage est responsable de la pénurie d'eau qu'a connu
la commune en 1976. Suite à cette sécheresse, la DDAF
a mené à la demande de la commune une campagne de recherche
en eau. J .C Prat, hydréologue départemental à
l'époque a focalisé les recherches sur les secteurs de
la commune a priori les plus intéressants ; à savoir là
où il était fort probable que les terrains soient fracturés
et que le bassin d'alimentation soit suffisamment large. Cette campagne
a fourni d'importantes informations quand à la géologie
de la Touchefouillère qui constituait avec la zone de l'étang
de Cadin et la zone de « Beauvais », l'un des trois sites
prospectés.
La méthode géophysique utilisée était la
prospection électrique, laquelle est basée sur l'aptitude
des terrains selon leur nature (grès ou schistes), leur structure
(compacte ou fracturée) et éventuellement les fluides
qu'ils contiennent à laisser passer les courants électriques
ou à indiquer leurs résistivités. Elle consiste
a injecter un courant continu dans deux électrodes plantées
dans le sol et à mesurer la différence de potentiel entre
deux autres électrodes.
Deux profils de résistivités orientés NW - SE ont
été réalisés entre le hameau de la Touchefouillère
et la route départementale ; deux sondages électriques,
orientés perpendiculairement aux profils les ont complétés.
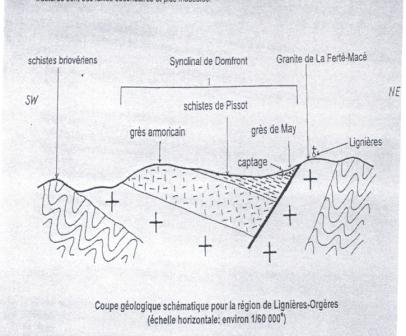 |
Cette prospection électrique réalisée, on a procédé
à un forage de reconnaissance et à un forage d'essai avant
de réaliser le forage d'exploitation. Le premier forage a atteint
au dessous de 40 mètres de profondeur des terrains argileux.
L'eau est apparue dès quatre mètres de profondeur et le
débit a augmenté de façon régulière
entre 13 et 46 mètres. Le débit obtenu en fin de foration
était de 25 mètres cubes / heure, ce qui laissait espérer
une capacité de production.
Ce forage est implanté dans des grès datant de l'ère
primaire appelés grès de May et au droit, à la
verticale d'une faille et à proximité de deux écrans
hydrauliques. Ces grès reposent eux-mêmes sur des schistes.
Un tel site est favorable à l'émergence de sources.
 |
Le captage produit un peu moins de 200 mètres cubes par jour
d'une eau de bonne qualité et pour laquelle la teneur en nitrate
évolue entre 20 et 25 mg/ litre. Le maximum autorisé étant
de 50 mg / litre
La nappe captée à la Touchefouillère constitue
une ressource dont le stock évolue en permanence en fonction
de l'exploitation du captage et du drainage des eaux atmosphériques.
Le volume d'eau qui transitait annuellement et en moyenne était
alors égal à 70000 mètres cubes. En fonction des
calculs effectués, l'eau exploitée quotidiennement ne
devait pas dépasser les 300 mètres cubes pour 20 heures
de pompage.
L'eau se situe à 48 mètres en dessous de la margelle et
sa profondeur est elle-même de plus de six mètres. L'aire
d'alimentation du captage est présumée s'étendre
essentiellement vers le nord et peu vers l'est. Une faille se situe
entre le captage et le hameau de la Touchefouillère. C'est pourquoi
le puits situé au centre de la Touchefouillère n'est jamais
influencé par l'exploitation du captage alors que celui à
l'Est de la Vannerie l'est.
Voici donc, rapidement résumée la manière dont
s'est réalisée ce forage et les caractéristiques
du sous-sol qui l'entoure.
