ORGERES
 |
MCI. —L'église, dont le chœur est roman, fut dotée
au xve siècle d'une tour accolée à la façade
ouest et qui, circonstance bien rare pour cette époque, porte
gravés en grands caractères gothiques le nom de l'ouvrier
et la date. Cette inscription se lit sur deux côtés d'une
pierre d'écoinçon, à l'angle sud-ouest, à
la hauteur de quatre environ.
Le nom qui figure ici, fréquemment porté encore dans le
pays au XVIIIe siècle, n'est point celui d'un curé, car
on n'aurait pas manqué de faire mention de sa qualité
par l'initiale de Messire et par la lettre P = prêtre. Ambroise
Denos ou Desnos est l'architecte de ce travail, bien exécuté,
en granit du pays, d'une certaine hardiesse d'élévation,
solide, mais sans aucun ornement. On ne saurait dire si le travail de
gravure a été fait avant ou après la pose de l'écoinçon.
Mais il n'est pas douteux que le millésime 1458 en chiffres arabes,
gravé en creux sur un fort moellon, ne soit une lecture fautive,
relativement moderne, des caractères assez peu lisibles de la
première date.
 |
MCII. — Le piédestal de la croix du cimetière a
une inscription commémorative, avec exhortation à la prière
pour les morts.
La croix a été faite et gravée par celui qui fit
le calvaire avec inscription du bourg de la Pallu et qui grava la première
pierre de l'église de Lignières, s'il n'en fut pas même
l'architecte. Ce nom reste toujours à trouver. Pierre Lemunnier
ou plutôt Lemeusnier est connu ; marchand tanneur à la
Motte-Fouquet, il fit de nombreuses acquisitions à Orgères
et donna en 1722 à Etienne Lemeusnier, son fils, un titre sacerdotal
sur immeubles au même lieu. François-Pierre Lemeusnier
était vicaire à Orgères en 1758.
 |
MCIII. — Sur la route de Lignières est une petite chapelle
dite de Guimbert ou de Notre-Dame-de-Grâces. Au linteau de la
porte sont gravés le nom du fondateur, la date et le vocable
de la chapelle.
Malgré l'inscription de 1711, postérieure comme on voit
de quatre-vingts ans à la fondation, le vocable a été
constamment Notre-Dame-de-Grâces. Noël Hubert, curé
de Saint-Thomas-de-Gourceriers, permuta au mois d'avril 1622 avec François
Huron, curé d'Orgères; par testament du 10 janvier 1650,
il dota la chapelle qu'il avait construite en 1639 d'une rente de 30#,
à charge de deux messes par mois. Une procession et une assemblée
eurent lieu autour de la chapelle jusqu'en 1831. Celui et celle qui
acceptaient les deux plus gros cierges étaient roi et reine,
tenaient la tête de la procession et devaient, l'année
suivante, rendre un cierge de même grosseur.
LIGNIERES
 |
DCCCXCIX. - - Lignières a la seule église reconstruite
toute d'une pièce au XVIIIe siècle qui existe dans le
département. Une tour ayant été bâtie à
la façade en 1898, on a retrouvé dans les fondations la
première pierre de l'église construite en 1712.
Le curé qui bâtit cette vaste église à ses
frais, Abel Mandoux, était un ancien missionnaire du Canada auquel
son successeur a consacré une note élogieuse et méritée
dans les Registres paroissiaux : « Me Abel Mandoux, originaire
de la paroisse de « Recueil, au-delà du Mans, curé
de Lignières, étoit entré dans la maison des Missions
Étrangères, à Paris ; ensuite il passa dans le
Canada en qualité de missionnaire pour prêcher la foy aux
sauvages et aux infidèles, et il fut curé dix ans de la
« petite ville des Trois-Rivières ; ensuite il s'en fut
à 400 lieues plus haut, dans l'Accadie, sur le même continent,
et y fut cinq ans, passant là son temps toujours dans «
l'exercice des fonctions apostoliques. Un traité de paix par
lequel Louis XIV céda « l'Accadie aux Anglois, fit revenir
M. Mandoux en France. Son mérite et sa piété lui
« firent donner, à son retour dans son pays, la cure de
Lignières par Mgr de Tressan, « alors évoque du
Mans, 1707. »
Le graveur de la pierre, qui est probablement l'entrepreneur ou architecte
de l'église, a également élevé les deux
calvaires de La Pallu en 1702 et d'Orgéres en 1705. Son nom reste
encore à découvrir, mais il était certainement
du pays.
On a relevé du pavage de l'église et mis à paver
la seconde sacristie plusieurs pierres tombales en granit bien conservées.
Toutes sont postérieures à la construction de l'église
actuelle.
 |
DCCCC. — La première contient une épitaphe rédigée
pour une épouse enlevée par une mort prématurée
et cruelle. Dans une forme très simple, elle exprime autant de
religion que de douleur sincère.
La dureté du granit s'est vraiment prêtée dans cette
circonstance à l'expression de nobles sentiments. Le D. O. M.
en tête de la dalle funéraire, le que Dieu absolve
intercalé dans l'épitaphe par l'époux si éprouvé
témoignent de sa foi, et c'est pour rendre ses regrets plus vifs
qu'il note le jour et l'heure de sa perte, l'âge par ans, mois
et jours de celle qu'il pleure. L'enfant, né le 7 décembre,
avait été baptisé à la maison en danger
de mort et présenté en outre à l'église
le même jour. Ces époux demeuraient à la Tripelière,
lieu qui avait été si cruellement visité par l'épidémie
en 1637 qu'on enterrait dans les jardins du village.
 |
DCCCCI. — Une grande dalle, dont toute l'inscription est en bordure,
sauf la date, est en partie cachée et le nom de la défunte
est coupé, mais je puis le compléter grâce à
l'acte d'émancipation de Jacques et Françoise Ernult,
enfants de Nicolas Ernult, sieur des Coutures, et de Françoise
Patrice, qui eut lieu en 1722 en présence de François
Patrice, médecin à Saint-Calais, et d'Isaac Ernult, sieur
des Coutures.
DCCCCII. — La tombe suivante est également un peu incomplète,
mais les noms sont respectés. Une particularité de la
gravure nous indique que l'ouvrier se servait du pochoir pour tracer
ses mots et même qu'il le plaçait quelquefois à
l'envers.
Je ne connais maître Charles Robidere que par un échange
d'immeubles qu'il fait avec Michel Forton en 1708 ; mais la famille,
très nombreuse sur cette lisière normande, s'est alliée
avec un membre de la famille d'Anthenaise.
 |
DCCCCIII. — Nous trouvons ensuite, par ordre de dates, la tombe
d'un curé de la paroisse; elle n'est pas plus luxueuse que les
autres, mais devait avoir sa place dans le chœur.
Urbain Loret, né en 1700 à Bonchamp de Jacques Loret,
notaire, et d'Urbaine Lambert, pourvu de son titre sur le Boulay de
Vaiges en 1721, « professa avec honneur la théologie au
séminaire de Domfront pendant dix ans », devint curé
de la Lacelle le 2 novembre 1732 et de Lignières le 4 novembre
1736. Son acte de décès porte qu'il fut « homme
d'esprit et de mérite, fort entendu dans les affaires. »
 |
DCCCCIV. — Nous ne représentons ici que la partie gravée
de la pierre tombale de la première maîtresse d'école
de Lignières, qui ne comprend que 0,85 de hauteur, tandis que
la dalle entière en a plus du double.
L'établissement avait été offert en 1700 aux Sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul; elles ne purent accepter. A la suite d'une
dotation de la comtesse de Tillières, les Sœurs de la Chapelle-au-Riboul
vinrent en 1704. Anne Lesage, dont le vrai nom était Sagehomme,
est qualifiée « supérieure de la communauté
des sœurs de charité de cette paroisse de Lignières
» dans son acte de décès, qui constate qu'elle fut
enterrée dans le cimetière. Elle avait soixante-quinze
ans à sa mort. Par testament olographe du 10 janvier 1744, elle
lègue « à ses compagnes sœurs de la charité
tous les acquêts qu'elle a faits de son bon ménagement
et de celui de ses compagnes, même une rente constituée
de 10#. Lesquels acquêts consistent dans une maison, fournil et
dépendances et dans une pièce de terre nommé le
Clos-Jacquin situé au bourg, pour par ses dites compagnes continuer
de faire les écoles aux jeunes filles et soulager les pauvres
malades. » Enfin elle lègue à ses compagnes sa part
des meubles et effets qu'elles avaient en société. Françoise
Lesage, qui fut aussi maîtresse, apparemment sœur ou nièce
d'Anne Lesage, mourut, âgée de quatre-vingt-huit ans, le
9 février 1776.
 |
DCCCCV. — Comme la précédente, la tombe du bailli
de Lignières n'est couverte qu'à moitié par l'inscription.
René Patrice de la Fuye, d'une famille anciennement connue à
Lignières dans la cléricature et les professions libérales,
mari de Gillette Foucher, était lieutenant civil et criminel
à Couptrain en 1746, bailli de la châtellenie de Lignières
et procureur du roi au grenier à sel de Carrouges, 1754, membre
du bureau de la Société d'agriculture du Mans. Deux de
ses fils furent prêtres. La famille s'est fixée à
Villaines-la-Juhel au XIXe siècle.
DCCGCVI. — La tombe d'Anne Garnier et de son mari étant
engagée en grande partie dans le mur et n'ayant point de date
dans la partie lisible, est presque impossible à attribuer.
On reconnaîtra facilement à la forme et à la dimension
des lettres que toutes ces inscriptions en relief, sauf peut-être
les deux premières, sont de la même main.
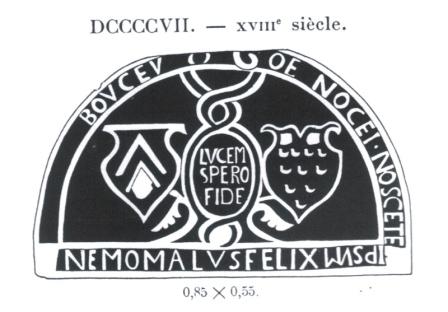 |
DCCCCVII. — Dans le bourg, une maison ancienne, dite le Château,
conserve deux belles plaques de foyer en fonte. L'une porte au centre
un écusson chargé d'un chevron accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'un lion. Les initiales R S sont
aux deux angles supérieurs de la plaque et M G aux angles inférieurs,
avec la date 1718 divisée par l'écusson.
La seconde a au centre un médaillon avec les mots LVCEM SPERO
FIDE et deux écussons chargés l'un d'un chevron, l'autre
de 10 merlettes, 4, 3, 2, 1. Au pourtour se lisent les sentences NOSCE
TE IPSVM et NEMO MALVS FELIX et d'autres mots peu intelligibles, peut-être
IOSEPH BOVCEY, nom du fondeur? Si le reste n'est pas du remplissage
fantaisiste, il est au moins incompréhensible. Nous avons trouvé
d'autres plaques de foyer avec inscriptions à Lévaré,
à Gorron et à Laval. Le tout peut provenir des forges
de la lisière normande. Le « château » de Lignières
appartenait, à la fin du XVIIIe siècle, à la famille
Forton.
Au linteau de la fenêtre d'une maison, proche de l'église,
se lit la date 1732.
DCCCCVIII. — Dans une cour où l'on entre par un porche,
le linteau d'une porte donnant actuellement entrée dans une boulangerie,
est marqué d'une initiale qu'on peut traduire probablement par
Gérard ou Gautier qui sont les noms les plus répandus
dans la paroisse.
DCCCCIX. — Sur la route de Cirai se trouve une croix dite «
Croix Legendre », du nom d'une famille anciennement connue au
pays. Si l'on doit voir dans les deux groupes d'initiales les noms de
deux époux, on pourrait lire M(ICHEL) BR(ETON) ET I(EANNE) LEG(ENDRE).
DCCCCX. — Une croix qui était encore entière il
y a vingt ans, mais qui n'a plus aujourd'hui qu'un seul tronçon
sur le piédestal, est également située sur la route
de Ciral ; elle est dite « Croix de Géladé ».
Jean Hermon, marchand, mari de Michelle Robidaire, fils de « gros
laboureur» », dit un acte de 1724, eut pour fils Charles
Hermon, qui eut son titre sacerdotal sur la Haie en 1757, fut curé
constitutionnel, puis apostat, de Sargé.
DCCCCXI. — A la sortie du bourg, sur la route de Joué-du-Bois,
la maison toujours habitée par la famille Pichon a sur son linteau
l'inscription qu'on doit lire : François Pichon.
Aux Yaux, une maison est datée de 1668.
DCCCCXII. — A la Haie-Portais, où habite
encore la famille Le Tur, un prêtre de la famille a laissé
graver son nom avec l'orthographe de la prononciation populaire et elliptique
L'TUR. Thomas Le Tur était vicaire à Lignières,
1742. 1745.
